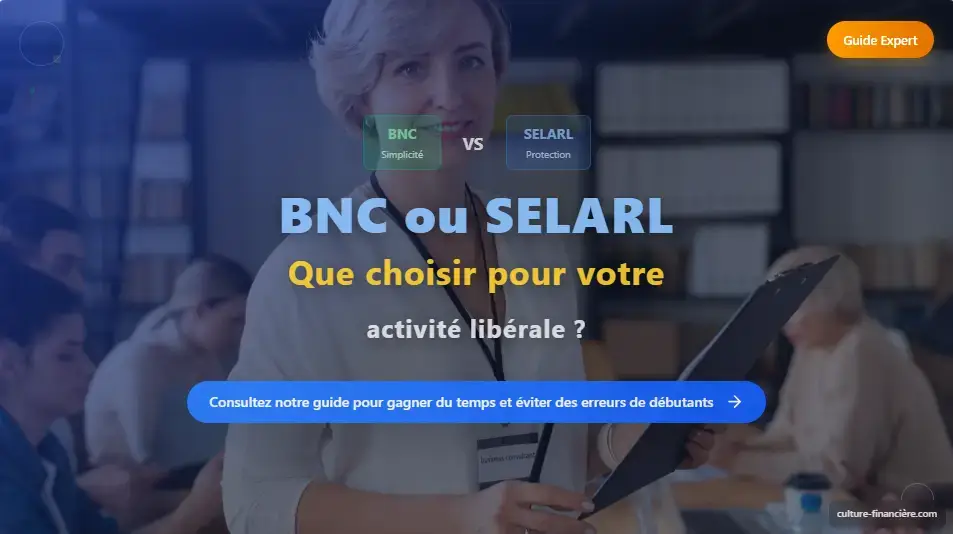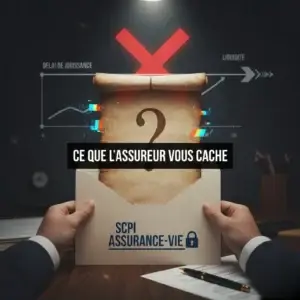Selon l’UNAPL (Union nationale des professions libérales Île-de-France), les professions libérales représentent près d’une entreprise sur trois en 2025.
Cette croissance s’accompagne d’enjeux structurels comme le choix de la forme juridique la plus appropriée pour proposer ses services.
Parmi les options envisageables, deux solutions sortent du lot : exercer sous le régime d’imposition des bénéfices non commerciaux (BNC) ou créer sa société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL).
Comment choisir l’approche qui correspond mieux à vos attentes ? Quels sont les pièges à éviter pour faire face aux nouveaux défis économiques de votre secteur ?
Simplicité administrative, revenus prévisionnels, protection patrimoniale… Nous passons en revue les critères à considérer pour effectuer le bon choix entre les BNC et la SELARL.
À lire aussi : Pacte Dutreil : Exemples & Schémas pour optimiser la transmission de votre entreprise
BNC ou SELARL : que choisir selon votre situation ?
En fonction de votre situation et de vos attentes, voici quelques indications pour vous aider à bien choisir votre structure juridique.
| Éléments à considérer | Quand opter pour le régime des BNC ? | Quand penser à la SELARL ? |
| Chiffre d’affaires annuel | Inférieur ou égal à 77 700 € (micro-BNC), de 77 700 € à 150 000 € (régime réel des BNC) | Supérieur à 150 000 €, croissance rapide prévue |
| Niveau de bénéfices nets | Inférieur à 50 000 € par an, revenus modestes et stables | Supérieur à 80 000 € par an, bénéfices élevés à optimiser |
| Charges professionnelles | Faibles (inférieur à 34 % du CA), peu d’investissements | Considérables, des investissements réguliers |
| Simplicité recherchée | Vous privilégiez la simplicité, expertise comptable non obligatoire, déclarations fiscales simples | Vous acceptez la complexité, gestion comptable lourde, obligations multiples |
| Protection patrimoniale | Pas de protection requise, activité peu risquée, patrimoine personnel limité | Protection nécessaire, activité à risque |
| Statut professionnel | Praticien débutant, exercice seul, activité récente | Praticien expérimenté, projet d’association, activité établie |
| Objectifs fiscaux | Acceptation de la fiscalité standard, pas d’optimisation complexe | Recherche d’optimisation fiscale poussée, répartition optimale du salaire ou des dividendes |
| Besoins en financement | Pas de gros emprunts, autofinancement suffisant | Crédits conséquents, recherche de crédibilité bancaire |
À lire aussi : Tout savoir sur les management fees holding

BNC : quelles sont les particularités de ce régime ?
Les bénéfices non commerciaux correspondent aux recettes perçues après soustraction du montant des charges déductibles.
Celles-ci incluent le loyer de vos locaux professionnels, les honoraires du cabinet comptable, les frais de formation pour obtenir un diplôme…
Quels sont les avantages des BNC ?
Les BNC proposent aux professions libérales des avantages qui dépendent de leur régime d’imposition : micro-BNC ou déclaration contrôlée.
Quels sont les atouts du régime réel des BNC ?
Il permet de réaliser de considérables économies, surtout en cas de charges élevées ou d’investissements réguliers.
Il est idéal pour amortir vos biens durables (ordinateurs, mobiliers, véhicules) sur de nombreuses années.
Cette option convient donc aux professions libérales qui veulent stabiliser le résultat imposable de leurs entreprises.
Quand vous êtes assujetti à la TVA, le régime réel des BNC vous offre la possibilité de déduire cette taxe de vos achats et investissements.
Sur le long terme, la récupération de la TVA peut représenter des montants significatifs à affecter à des postes stratégiques :
- acquisition de matériel performant,
- recours à des prestataires spécialisés,
- développement de votre présence en ligne.
Le régime réel des BNC vous garantit la tenue d’une comptabilité détaillée qui vous assure une bonne lecture de votre rentabilité.
Vous en avez besoin pour piloter votre activité, anticiper les évolutions économiques de votre secteur et attirer beaucoup de partenaires.
Avec une comptabilité transparente, vous gagnez la confiance de vos clients, des organismes financiers et de l’administration fiscale.
Elle vous donne accès à des financements ou appels d’offres dédiés aux sociétés qui respectent les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
Le régime réel des BNC facilite votre accessibilité à de nombreux crédits d’impôt comme ceux destinés au soutien des charges familiales ou de formation des dirigeants.
À lire aussi : Comment payer moins d’impôts lors de la cession de son entreprise ? 8 stratégies gagnantes
Quels sont les avantages du régime micro-BNC ?
La tenue d’un livre de recettes suffit pour garantir la traçabilité des transactions financières. Cela implique moins de dépenses, car l’assistance d’un expert-comptable n’est pas obligatoire.
Le régime de micro-BNC vous donne droit à un abattement forfaitaire automatique de 34 % sur les profits déclarés pour les frais professionnels, avec un montant minimum de 305 €.
Sous réserve d’éligibilité, il vous offre l’opportunité de procéder à un versement libératoire de votre impôt sur le revenu (IR). Ce système facilite aussi le paiement des cotisations sociales.
Les déclarations annuelles se font directement sur le formulaire d’impôt sur le revenu n° 2042 C-PRO disponible sur impot.gov.fr. Ce processus simplifie la gestion des obligations fiscales.
Bon à savoir !
Le régime micro-BNC est avantageux tant que les charges réelles de votre entreprise restent inférieures à l’abattement forfaitaire.
Quels sont les inconvénients des BNC ?
À l’image des avantages, les contraintes des BNC sont liées au régime d’imposition que vous avez adopté.
Quelles sont les limites associées à une déclaration contrôlée ?
Quand vous exercez une activité libérale sous le régime réel des BNC, tout votre bénéfice est imposable. Cela peut impacter votre revenu net disponible et votre trésorerie.
Selon les articles 2284 et 2285 du Code civil, vous êtes responsable des passifs et dettes de votre entreprise.
En cas de défaillance, les créanciers sont autorisés à saisir vos biens personnels pour couvrir les prêts professionnels contractés.
La déclaration contrôlée augmente votre charge administrative et implique souvent de nouvelles dépenses.
Elle ne vous offre pas la possibilité de bénéficier de l’abattement forfaitaire de 34 % et limite ainsi votre optimisation fiscale.
Quelles sont les contraintes du micro-BNC ?
Le régime micro-BNC ne donne droit à aucune déduction des charges réelles et engendre une fiscalité lourde.
Vous ne récupérez pas de TVA sur vos achats et investissements. Dans ce système, votre chiffre d’affaires annuel reste limité à 77 700 €.
En tant que professionnel libéral, vous n’avez pas la possibilité d’amortir vos investissements, de générer un déficit fiscal ou de déduire un emprunt.
Quand vous exercez sous ce régime, vous n’avez pas accès à des aides comme les dispositifs ZFU ou ZRR.
Le calcul des cotisations sociales dépend de votre chiffre d’affaires. Cela conduit à un grand déséquilibre financier si votre activité est peu rentable.
À lire aussi : 8 solutions pour donner son entreprise à son enfant sans payer trop d’impôts
Comment sont imposés les bénéfices non commerciaux ?
Le barème progressif de l’impôt sur le revenu s’applique sur vos profits et le montant obtenu varie selon votre chiffre d’affaires.
L’administration fiscale effectue un prélèvement automatique au plus tard le 15 du mois et se base sur les recettes déclarées l’année précédente.
Si vous le souhaitez, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) peut le faire tous les 90 jours comme il suit :
- avant le 15 février,
- au plus tard le 15 mai,
- avant le 15 du mois d’août.
Pour profiter de ce privilège, faites une demande auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend votre structure.
Attention !
Si vous ne réalisez pas votre déclaration ou le faites après les délais impartis, vous vous exposez à une majoration de 10 à 80 % des sommes dues.
Une déclaration annuelle des bénéfices incomplète entraîne par contre une augmentation du montant à payer de 5 %.
Cas pratique : comment calculer l’impôt sur des bénéfices non commerciaux ?
Comprendre le mécanisme de calcul de l’impôt en BNC vise à anticiper sa charge fiscale et optimiser ses déclarations.
Voici deux exemples pour illustrer les étapes du calcul et les spécificités de chaque régime d’imposition.
Exemple 1 : Sébastien est avocat soumis au régime réel
Hypothèses :
- Chiffre d’affaires annuel : 150 000 €
- Charges professionnelles déductibles : 50 000 € (loyer, salaire assistant, cotisations sociales…)
- Revenu net imposable (BNC réel) = 150 000 – 50 000 = 100 000 €
- Célibataire, 1 part fiscale
Calcul de l’IR :
- Revenu net imposable = 100 000 €
Application du barème par tranches :
- Jusqu’à 11 294 € : 0 % = 0 €
- 11 295 à 28 797 € (soit 17 503 €) : 11 % = 1 925 €
- 28 798 à 82 341 € (soit 53 543 €) : 30 % = 16 063 €
- 82 342 à 100 000 € (soit 17 658 €) : 41 % = 7 244 €
- Impôt total = 0 + 1 925 + 16 063 + 7 244 = 25 232 €
Sébastien paie 25 232 € d’impôt sur le revenu. Le régime réel lui a permis de déduire toutes ses charges. Sans cela, il aurait payé plus de 40 000 €.
Exemple 2 : Emmanuella est une dentiste assujettie au micro-BNC
Hypothèses :
- Célibataire, 1 part fiscale
- Recettes encaissées : 80 000 €
- Pas de comptabilité complexe ni de déduction de charges réelles
- Régime micro-BNC : abattement forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €
Calcul du revenu imposable :
- Abattement = 80 000 × 34 % = 27 200 €
- Revenu net imposable = 80 000 – 27 200 = 52 800 €
Application du barème IR :
- Jusqu’à 11 294 € : 0 % = 0 €
- 11 295 à 28 797 € (soit 17 503 €) : 11 % = 1 925 €
- 28 798 à 52 800 € (soit 24 002 €) : 30 % = 7 200 €
- Impôt total = 0 + 1 925 + 7 200 = 9 125 €
Emmanuella paie 9 125 €. Le régime micro-BNC est certes souple, l’empêche de déduire ses charges réelles.
À lire aussi : Trade Republic ou Boursorama : frais, offres… on a tout comparé pour vous !

SELARL : que savoir sur cette structure juridique ?
Réservée aux professions libérales réglementées par un Ordre professionnel, la SELARL appartient à la famille des sociétés d’exercice libéral (SEL).
Les règles qui encadrent le fonctionnement de ce statut sont définies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Pourquoi exercer en SELARL ?
La responsabilité des associées d’une SELARL est limitée au moment de leurs apports. En cas de défaillance de la société, les créanciers ne peuvent pas les poursuivre.
Identique à une SARL, cette mesure vous offre une protection juridique et vous garantit une vie professionnelle sereine à l’abri de risques financiers personnels.
Avec ce statut juridique, les cotisations sociales sont calculées sur la rémunération réelle des actionnaires qui réalisent ainsi de considérables économies.
Les bénéfices conservés dans la société sont certes imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), mais pas à l’IR tant qu’ils ne sont pas distribués.
Cela vous donne l’occasion de répartir le paiement de vos taxes sur de nombreuses années et d’optimiser vos distributions en fonction de vos attentes.
En cas d’apport en nature, le Code général des impôts prévoit un report de la taxation de la plus-value latente.
Ce mécanisme facilite la transformation d’une activité individuelle en société sans pénalité fiscale immédiate.
Ce report d’imposition de la plus-value latente peut être prolongé jusqu’à la réalisation des événements suivants :
- changement d’activité,
- vente de vos parts sociales,
- rachat de vos titres par la société.
Quand vous exercez en SELARL, vous définissez votre niveau de rémunération soumis aux cotisations sociales et le montant des dividendes assujetti au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %.
Selon vos objectifs (préparation de la retraite, réalisation d’investissement), cela vous aide à optimiser le ratio entre charges sociales et fiscalité personnelle.
Votre firme peut être exonérée des droits d’enregistrement si vous vous engagez à conserver vos parts pendant une durée minimale de trois ans.
À lire aussi : Assurance-vie Société Générale : notre avis sans filtre
Quels sont les inconvénients d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée ?
La création d’une SELARL est une bonne stratégie pour sécuriser votre activité libérale, mais elle implique le paiement des cotisations sociales lors de la distribution des dividendes.
En 2026, la limite fixée est égale à 10 % du capital social auquel s’ajoutent les primes d’émission et le solde du compte courant d’associé.
Si ce seuil est par exemple de 5 000 € et que vous percevez 15 000 € de dividendes, 10 000 € seront soumis à environ 45 % de charges sociales, soit 4 500 € de cotisations.
Dans une SELARL, la cession des parts à un tiers nécessite l’accord des ¾ des associés. Une telle condition peut empêcher une transmission ou sortie en cas de mésentente.
Si votre structure est constituée de quatre praticiens à parts égales, il suffit qu’un seul s’oppose pour annuler la vente.
À l’image des sociétés pluripersonnelles, les divergences de vision, de gestion ou de répartition des bénéfices peuvent entraîner des tensions.
En l’absence d’un pacte d’associés conforme, ces conflits conduisent souvent à des procédures judiciaires ou au blocage des solutions stratégiques.
Votre responsabilité civile ou pénale peut être engagée en cas de faute de gestion, négligence ou manquement à vos obligations.
Un médecin associé dans une SELARL peut être poursuivi s’il commet une erreur médicale grave ou s’il est condamné pour une faute professionnelle.
Comment sont imposés les bénéfices dans une SELARL ?
Les profits d’une SELARL sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %. Le montant de l’IS se calcule à partir des résultats du dernier exercice clos.
Chaque année, vous devez effectuer votre déclaration de résultat n° 2065 trois mois au plus après la clôture de son exercice comptable.
Si votre exercice est clos le 31 décembre ou pas en cours d’année, vous avez jusqu’au deuxième jour ouvré après le 1er mai pour réaliser votre déclaration.
Bon à savoir !
Une SELARL est capable de bénéficier d’un taux réduit de 15 % sur ses 42 500 premiers euros de bénéfice.
Pour cela, son chiffre d’affaires hors taxes doit rester inférieur à 10 000 000 €. Son capital doit en plus être libéré et détenu à hauteur de 75 % au minimum par des personnes physiques.
Exemple :
La SELARL Dentistes Associés clôture son exercice le 31 décembre 2024.
- Résultat fiscal de l’exercice : 120 000 €
- Chiffre d’affaires HT : 800 000 €
- Capital : totalement libéré et détenu à 100 % par des personnes physiques
La SELARL remplit les conditions pour profiter du taux réduit à 15 % sur ses 42 500 premiers € de bénéfice.
Calcul de l’IS :
- Sur les 42 500 premiers € : 42 500 × 15 % = 6 375 €
- Sur le reste du bénéfice (120 000 – 42 500 = 77 500 €) : 77 500 × 25 % = 19 375 €
- IS total dû = 6 375 + 19 375 = 25 750 €
- Résultat net après IS : 120 000 – 25 750 = 94 250 €.
Ce montant peut ensuite être distribué aux associés sous forme de dividendes ou être conservé dans la société pour renforcer les fonds propres.
À lire aussi : Meilleur placement bancaire : lequel choisir ?
Quel est le régime fiscal des associés d’une SELARL ?
En tant que personne physique et associée d’une SELARL, votre rémunération est depuis le 1er janvier 2024 classée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Si vos recettes hors taxes de l’année N-1 ou N-2 n’excèdent pas 77 700 €, vous êtes assujetti au régime micro-BNC. Au-delà, le régime applicable est celui de la déclaration contrôlée.
Les dividendes que la société vous verse sont soumis au PFU ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le choix de la bonne option se fait à la suite de multiples simulations.
Attention !
Si vous êtes le gérant majoritaire de votre SELARL, vous appartenez à la classe des travailleurs non-salariés (TNS) et affiliés à la Sécurité sociale des indépendants (SSI).
Quand vous êtes minoritaire, vous devenez un assimilé-salarié, soumis au régime général de la Sécurité sociale.
Comment fonctionne une SELARL ?
Dans une SELARL, la majorité des associés doivent être des praticiens. Les actionnaires non professionnels doivent rester minoritaires.
Cette structure n’exige pas de capital social minimum. Les apports se font en numéraire, en nature ou mixte.
La gestion d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée est assurée par un ou plusieurs dirigeants choisis parmi les associés (personnes physiques).
Une SELARL est soumise aux mêmes obligations qu’une entreprise commerciale traditionnelle. Elle doit tenir une comptabilité régulière, établir des comptes, déposer ses déclarations de résultats, etc.
Elle se compose d’au moins deux associés et de 100 actionnaires au maximum. Si vous décidez de la créer seul, elle deviendra alors une SELARLU (SELARL unipersonnelle).
Comment créer une société d’exercice libéral à responsabilité limitée ?
La mise en place d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée s’effectue en quatre étapes successives :
- rédaction des statuts de la société,
- inscription ou obtention de l’agrément auprès de l’organisme de la profession libérale réglementée,
- publication de l’avis de constitution de la SELARL dans un journal d’annonces légales,
- immatriculation de la société par envoi du dossier complet au greffe du Tribunal de compétent.
Pour éviter des erreurs, sollicitez l’assistance d’un avocat, expert-comptable et formaliste. La présence d’un commissaire aux apports peut être exigée en cas de besoin.
À lire aussi : Comment payer moins d’impôts ? Les 12 meilleures solutions
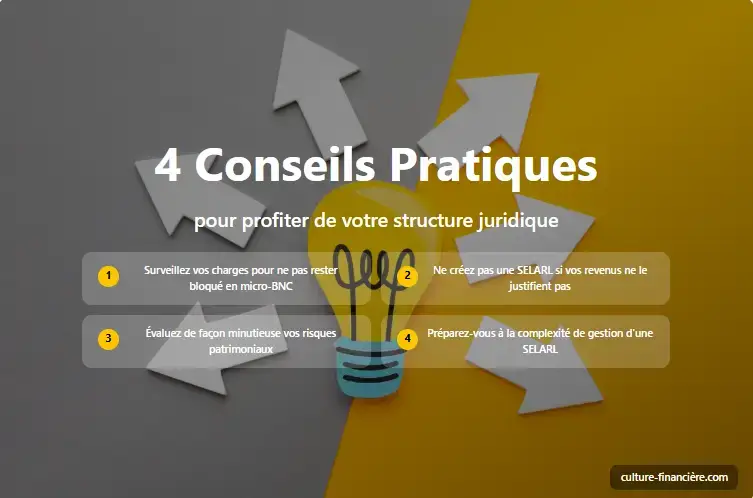
4 conseils pratiques pour profiter de votre structure juridique
Pour tirer le meilleur parti de votre structure juridique, évitez les pièges fréquents susceptibles de transformer une bonne décision en un considérable poste de dépenses.
Voici quatre conseils concrets basés sur les erreurs observées chez les professionnels libéraux pour optimiser votre situation fiscale et juridique.
Surveillez vos charges pour ne pas rester bloqué en micro-BNC
Beaucoup de professionnels libéraux n’osent pas sortir du régime micro-BNC sans réaliser qu’ils paient des impôts sur des revenus fictifs.
Prenons l’exemple d’un consultant qui encaisse 75 000 €, mais qui supporte des charges réelles à hauteur de 35 000 €.
En micro-BNC, il ne bénéficie que d’un abattement de 25 500 € (34 % de 75 000 €). Il paie donc des impôts sur 49 500 € alors que son véritable bénéfice n’est que de 40 000 €.
La solution consiste à passer au régime BNC au réel dès que vos charges dépassent 34 % de votre chiffre d’affaires.
Ce changement vous aide à déduire vos frais réels comme votre loyer professionnel, vos cotisations, honoraires de comptable… Cette économie fiscale peut vite atteindre plusieurs milliers d’euros par an.
Ne créez pas une SELARL si vos revenus ne le justifient pas
La SELARL séduit par ses avantages fiscaux et sa protection patrimoniale, mais elle génère des coûts fixes :
- coûts de location de véhicules,
- frais de création (1 500 à 3 000 €),
- honoraires d’expert-comptable (3 000 à 8 000 € par an).
Le seuil de rentabilité se situe en général autour de 80 000 € de bénéfices nets annuels. En dessous, les économies réalisées sur les cotisations sociales et l’optimisation fiscale ne compensent pas les charges supplémentaires.
Avant de passer à une SELARL, effectuez une simulation complète qui intègre tous les coûts (gestion courante, obligations déclaratives).
Demandez au moins trois devis d’experts-comptables et comparez avec votre situation actuelle en BNC. La SELARL ne doit être envisagée que si l’économie dépasse 5 000 € par an.
À lire aussi : Faut-il investir quand on est jeune dans l’assurance-vie ?
Évaluez de façon minutieuse vos risques patrimoniaux
Nombreux sont les professionnels libéraux qui minimisent les risques de leur activité et découvrent trop tard que leur responsabilité civile ou professionnelle peut engager leur patrimoine personnel.
En BNC, tous vos biens (résidence principale, placements) peuvent être saisis pour couvrir les dettes de votre firme.
Pour estimer ce risque, analysez votre secteur en tenant compte des facteurs tels que la fréquence des litiges, les montants moyens des condamnations…
Consultez votre assurance responsabilité civile professionnelle pour connaître les plafonds et les exclusions définis par votre prestataire.
Si vous possédez un patrimoine significatif (supérieur à 200 000 €), privilégiez la protection offerte par la SELARL.
Les solutions alternatives comme la déclaration d’insaisissabilité de votre résidence principale ou l’optimisation de vos contrats d’assurance peuvent être utiles.
Préparez-vous à la complexité de gestion d’une SELARL
Créer une SELARL implique de passer d’une gestion simple (BNC) à celle d’une véritable société avec toutes ses contraintes (comptabilité d’engagement, déclarations de TVA…).
Beaucoup de professionnels découvrent après coup qu’ils doivent consacrer de nombreuses heures par mois à ces tâches ou débourser des sommes conséquentes pour les déléguer.
Choisissez un expert-comptable spécialisé dans les professions libérales qui maîtrise les spécificités des SELARL.
Vous devez prévoir un budget réaliste qui regroupe les coûts de comptabilité, de conseil juridique, de formalités…
Formez-vous aux obligations de base ou confiez la gestion administrative de votre société d’exercice libéral à responsabilité limitée à un expert.
Vous devez mettre en place des outils de pilotage (tableaux de bord, indicateurs financiers) pour garder le contrôle de votre activité.
À lire aussi : Donation terrain agricole famille : démarches, fiscalité, optimisation…
Conclusion
Le choix d’exercer en BNC ou de passer à la SELARL dépend de votre situation personnelle et de vos objectifs.
Faites des simulations pour adopter la structure juridique qui correspond mieux à votre profession libérale.
Sollicitez aussi l’assistance d’un expert spécialisé pour gagner du temps, sécuriser vos activités et éviter des erreurs.
FAQ
Comment s’associer en SELARL ?
Il faut au moins 2 associés qui exercent tous la même profession libérale.
Peut-on passer de BNC à SELARL ?
Oui, c’est possible si les associés réalisent un apport ou une cession de parts, rédigent des statuts conformes et obtiennent l’agrément de l’ordre professionnel avant l’immatriculation de la société.
Combien puis-je économiser avec une SELARL ?
La SELARL offre la possibilité d’optimiser sa fiscalité à travers la déduction des salaires, l’imposition réduite des dividendes et le report de la plus-value.
Quelles sont les professions libérales concernées par des BNC ou la SELARL ?
Avocats, médecins, experts-comptables, architectes, notaires, kinésithérapeutes… Toutes les professions libérales soumises à un ordre professionnel.
Ma profession nécessite-t-elle vraiment une protection patrimoniale ?
Oui, car elle sert à sécuriser vos revenus, votre famille, votre retraite et anticiper les risques financiers propres à votre profession.
Comment optimiser la répartition de votre salaire ou de vos dividendes ?
Nous recommandons de combiner salaire modéré et dividendes pour un équilibre fiscal, social et patrimonial optimal.